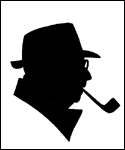 |
La naissance
de Maigret
Article |
-
Rédaction
Epalinges (Vaud, Suisse), le 24 mars 1966.
-
Manuscrit
7 feuilles dactylographiées ; 29,7 x 12,3 cm ; avec corrections manuscrites, datées de : Epalinges, le 24 mars 1966.
Conservation : collection privée [ ? ] ; photocopie au Fonds Simenon (Liège, Belgique).
-
Publication d'une préoriginale
Aucune.
-
Edition originale
Sous le titre : De geboorte van Maigret.
Achevé d'imprimer : 1966.
Utrecht, Bruna & Zonn ; 17,5 x 11,5 cm, 173 et 176 pages [impression tête-bêche avec un cahier central non paginé] ; illustrations (photos).
Texte en néerlandais accompagnant la publication, dans la même langue, du Château des Sables Rouges et Maigret et l'affaire Nahour.
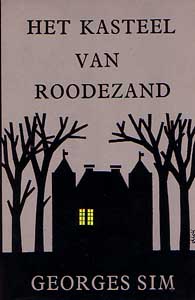

Het kastel van Roodezand et Maigret en de zaak Nahour, 1996.
Contient le texte : De geboorte van Maigret.
Edition originale.
-
Réédition / Edition collective
Première publication du texte en français.
In Œuvres complètes, tome I.
Achevé d'imprimer : 1967.
Lausanne, Editions Rencontre ; 18,5 x 12,5 cm, pages 7-11 ; reliure d'édition bleu marine.
Edition établie par Gilbert Sigaux.
Ce texte sera repris dans Portrait-souvenir de Blazac (Paris, Bourgois, 1991).
-
Remarque(s)
Lire aussi les notices suivantes :
• Maigret reprend du du service (1934) ;
• A la retraite, le commissaire Maigret ! (1937) ;
• Un frère aîné de Maigret (1963) ;
• Lettre à Maigret pour son cinquantième anniversaire, 1979 (1979) ;
• Simenon, répondez ! (1952).
-
Texte intégral
Pourquoi Jules-Amédée-François Maigret, commissaire divisionnaire de la Police Judiciaire et chef de la Brigade criminelle, quai des Orfèvres à Paris, français cent pour cent, est-il né dans le port de Delfzijl, le plus septentrional des Pays-Bas, au bord de l'Ems, c'est ce que je voudrais essayer de raconter sans être sûr que le lecteur trouve le même plaisir que moi à ces réminiscences.
J'ai maintenant soixante-trois ans, Maigret environ cinquante-deux.
Lorsque je l'ai créé, à vingt-cinq ans, il en avait quarante-cinq.
Ainsi a-t-il eu la chance de vieillir beaucoup moins rapidement que moi et sans doute garderai-je encore longtemps son âge actuel.
Pourquoi la Hollande ? Pourquoi Delfzijl ? Il faut remonter à une année plus tôt.
A vingt-quatre ans, l'envie m'était venue de connaître la France dans ses moindres recoins et j'avais découvert que les villes ou les villages ne montrent, du côté de la grand-route ou de la gare, que leur visage le plus banal ou le plus renfrogné, réservant leur intimité et leur vie secrète aux rivières et aux canaux.
J'achetai donc un bateau de cinq mètres, le Ginette, qui avait dû servir de canot de sauvetage à un yacht plus prestigieux. J'y fis installer un taud assez compliqué me permettant, la nuit, de transformer l'embarcation en cabine de toile.
Un moteur hors-bord de trois chevaux. Un cabot en remorque pour la machine à écrire, les vêtements et les casseroles. C'est dans ces conditions que je fis, en 1927, le tour de France, du nord au midi, de l'est à l'ouest, franchissant environ un millier d'écluses de tous modèles, certaines datant de Vauban.
Sous une tente que je dressais au bord de l'eau, j'écrivais chaque jour deux ou trois chapitres de romans populaires. Le camping était peu pratiqué à l'époque et j'étais souvent entouré de paysans ou de mariniers qui venaient contempler l'hurluberlu, en short et torse nu, qui tapait furieusement à la machine sur un chemin de halage ou à l'orée d'un bois.
Je n'étais pas peu fier, je l'avoue des nombreux papiers officiels qui m'avaient été remis avant mon départ. Comme j'avais à passer par la mer pour me rendre d'un estuaire à l'autre, un des documents commençait par : « Nous, président de la République française…», et, traitant ma modeste embarcation de navire, priait les souverains étrangers de bien vouloir me prêter aide et assistance en cas de besoin.
Cela me monta-t-il à la tête ? Dès octobre, j'étais à Fécamp, où je faisais construire un cotre sur le modèle des bateaux de pèche de la Manche. C'était un bateau de dix mètres de long, de quatre mètres de large, de deux mètres de tirant d'eau, aux membrures puissantes et à la coque de chêne épais.
Terminé au printemps, je l'amenai d'abord à Paris, où je l'amarrai au square du Vert-Galant et où, sans modestie, je le fis baptiser en grande pompe par le curé de Notre-Dame.
Mon nouveau navire s'appelait l'Ostrogoth. Quelques mois plus tard, il pénétrait dans le port de Delfzijl, qui n'avait pas son importance d'aujourd'hui.
J'étais amarré dans l'avant-port, face aux bateaux-pilotes, et je me souviens particulièrement de la découverte que je fis de la ville rose, entourée de digues, de ses portes qui ne sont pas destinées à décourager des assaillants éventuels mais, par mauvais temps, à empêcher la mer de s'engouffrer dans les rues.
Je garde un autre souvenir de ce premier contact avec une région que je devais revoir plusieurs fois par la suite. En passant par Sneek, après avoir traversé ce qui s'appelait alors le Zuyderzee, nous avions acheté, ma femme, notre cuisinière-moussaillon et moi, d'épais costumes que les Hollandais ont conçus et très bien conçus pour la navigation à voile. C'est dans ces vêtements, qui comportaient bien entendu des pantalons, que nous fîmes tous les trois notre première incursion dans les rues de la ville.
Etait-ce cet accoutrement, le fait qu'on était pas encore habitué à voir des femmes en pantalon ? Des enfants nous suivaient, de plus en plus nombreux, se risquant parfois très près de nous pour nous crier, avant de s'échapper à prudente distance :
— Met lydt !
Ce qui, je l'appris plus tard, signifie : « Ayez pitié ! »
Notre séjour à Delfzijl devait se prolonger plus que prévu et je bénis aujourd'hui la voie d'eau que je découvris après quelques jours. Un brave charpentier de bateaux, Mijnheer Roels, vint examiner la blessure, avec la gravité et l'autorité d'un médecin, pour décider que l'Ostrogoth avait besoin d'un recalfatage complet, de sorte que je dus conduire le bateau en cale sèche au bord du vieux canal.
J'avais gardé, comme pendant mon tour de France, l'habitude d'écrire deux ou trois chapitres par jour. Je me rendis vite compte que c'était impossible dans une coque rendue sonore comme une cloche par les calfats qui la frappaient à grands coups de masse du matin au soir.
Je me serais cru déshonoré de louer une chambre à l'hôtel. Le hasard me fit découvrir, à moitié échouée, au bord du canal, une vieille barge qui semblait n'appartenir à personne. On y pataugeait dans trente à quarante centimètres de cette eau rougeâtre particulière au vieux canal, toujours couvert de troncs d'arbres que les cargos amenaient de Riga et qui dérivaient paresseusement vers Groningen.
Cette barge, où j'installai une grande caisse pour ma machine à écrire, une caisse un peu moins importante pour mon derrière, deux caisses de format plus réduit encore pour mes pieds, allait devenir le vrai berceau de Maigret.
Pas tout de suite, cependant. Pendant que Mijnheer Roels et ses hommes soignaient mon bateau, puis, de noir qu'il était auparavant, l'habillaient de blanc, vernissant en perfectionnistes le plat-bord, le mât et les vergues, installant enfin un somptueux compas de cuivre que j'avais acheté chez un sbiplander proche de l'écluse, je faisais peu à peu connaissance avec un pays qui m'enchantait.
Ce pays, j'ai alors essayé de le dépeindre dans un de mes derniers romans populaires, Le château des Sables Rouges.
Qu'allais-je écrire ensuite ? Depuis un certain temps, je pressentais la fin de mon apprentissage, composé de nombreux contes et romans écrits sous quinze ou seize pseudonymes. J'hésitais encore à aborder un genre plus difficile, sinon plus sérieux.
Je me revois, par un matin ensoleillé, dans un café qui s'appelait, je crois, Le Pavillon, où le patron passait des heures, chaque jour, à polir ses tables de bois à l'aide d'huile de lin. Je n'ai jamais revu de tables aussi luisantes de ma vie.
A cette heure, il n'y avait personne autour de la grande table centrale, familière aux Hollandais, où les journaux bien pliés attendent sur des tringles de cuivre leurs habitués.
Ai-je bu un, deux, ou même trois petits genièvres colorés de quelques gouttes de bitter ? Toujours est-il qu'après une heure, un peu somnolent, je commençais à voir se dessiner la masse puissante et impassible d'un monsieur qui, me sembla-t-il, ferait un commissaire acceptable.
Pendant le reste de la journée, j'ajoutai au personnage quelques accessoires : une pipe, un chapeau melon, un épais pardessus à col de velours. Et comme il régnait un froid humide dans ma barge abandonnée, je lui accordai, pour son bureau, un vieux poêle de fonte.
Le lendemain à midi, le premier chapitre de Pietr-le-Letton était écrit. Quatre ou cinq jours plus tard, le roman était terminé.
Si, dans l'ordre de parution, il n'a pas été le premier de la série, mais le troisième, cela ne fut dû qu'au hasard.
Il y eut d'ailleurs d'autres hasards dans cette affaire. Non seulement Maigret venait de naître à Delfzijl à cause d'une voie d'eau, mais à cause de lui, j'allais reprendre mon véritable nom, que je n'avais jamais employé pour mes romans populaires.
Nous cherchions, l'éditeur Fayard et moi, un pseudonyme définitif. Nous en avions trouvé et repoussé une bonne quarantaine quand Fayard me demanda :
— Au fait, comment vous appelez-vous réellement ?
Je répondis, presque piteux :
— Georges Simenon.
Car je considérais ce nom comme banal et difficile à prononcer à cause de l'e muet.
Il est vrai que je n'en pensais pas moins de Jules Maigret.
Georges Simenon
Epalinges, le 24 mars 1966
|
• Apporter une information complémentaire
ou une correction : cliquer ici • |
|